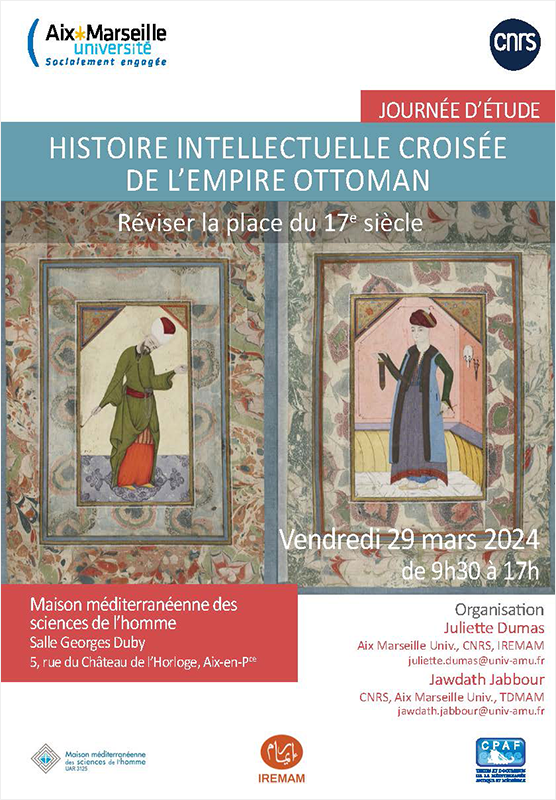Affiche @ Patricia Zuntow, TDAM
Journée d'étude "Histoire intellectuelle croisée de l’Empire ottoman. Réviser la place du 17e siècle"
Vendredi 29 mars 2024, 9h30-17h, MMSH, salle Duby, Aix-en-Provence. Organisée par Juliette Dumas (Aix Marseille Univ., CNRS, IREMAM) et Jawdath Jabbour (CNRS, Aix Marseille Univ., TDMAM). Télécharger le programme (conception Patricia Zuntow, TDAM).
Présentation
L’ouverture massive des archives turques, la meilleure accessibilité aux manuscrits et la révision de la place de l’Empire ottoman dans les récits nationaux, ont conduit à une croissance phénoménale des études d’histoire ottomane. En quelques décennies, de vastes champs de la recherche ont été ouverts, révisant des pans entiers de l’historiographie.
Pour autant, certains présupposés sur l’histoire ottomane – et plus particulièrement sur l’histoire intellectuelle – persistent encore. La représentation du XVIIe siècle dans l’historiographie moderne en est un exemple frappant Le « long 17e siècle » continue d’apparaître comme une ère de décadence d’abord politique, mais aussi culturelle et artistique. Les maigres études sur cette période restent écrasées entre la magnification d’un âge d’or s’arrêtant au dernier quart du 16e siècle, et une révision historiographique frappant d’abord le 19e, puis le 18e siècle, comme âge de raison et de modernisation.
Or, rien n’est moins sûr que ce présupposé dont des études récentes, comme celles de Khaled el-Rouayheb sur la philosophie et la logique ottomane, commencent à montrer les limites. L’apparition des premières bibliothèques publiques à Istanbul, l’accroissement massif de copies et de traductions d’ouvrages rapportés ou issus des provinces arabes ou des terres safavides, l’émergence de transferts culturels avec l’Europe, la consolidation de cursus d’études, la démultiplication des espaces d’éducation et la virulence de débats théologiques comme de traités politiques et d’éthiques, laissent à penser que ce siècle n’est peut-être pas celui du marasme intellectuel dans lequel on l’a décrit.
Tout laisse à penser qu’une des raisons de la persistance de cette croyance à un âge sombre réside dans la fragmentation des études sur cette période de l’histoire de la pensée ottomane : entre la capitale et la périphérie, entre la production en arabe et celle en turc ottoman, l’histoire de l’art, l’histoire de la pensée et l’histoire tout simplement. Une histoire croisée de l’histoire intellectuelle ottomane s’impose pour interroger cette période méconnue dans ses apports et ses réflexions intellectuelles, interroger son rôle de transition et remettre en question certaines divisions telles que le conservatisme traditionnel et la modernité ou l’opposition entre repli sur soi, influence iranienne et l’européanisation.